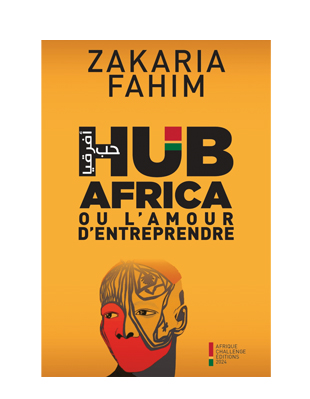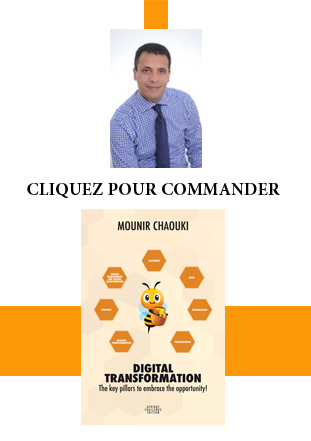Alors que la lutte que se livrent les États-Unis et la Chine en Afrique cristallise toutes les attentions, la Turquie joue plus discrètement des coudes avec le géant asiatique sur le continent dans des domaines aussi variés que la construction des infrastructures, l’extraction des ressources naturelles, les équipements militaires et les accords sécuritaires.
La Chine et la Turquie profitent de la volonté de nombreux pays africains de s’affranchir du monopole politique, économique et commercial dont les acteurs occidentaux ont pu bénéficier par le passé. Les deux pays, qui jouent sur le registre anticolonialiste, peuvent cependant voir leurs discours et leurs intérêts entrer en conflit ou être mis en concurrence par les dirigeants ou les populations africaines.
Dans le domaine du Soft Power, les deux puissances mobilisent la mémoire d’une impérialité douce et ancienne sur le continent africain, qu’ils présentent comme étant nettement distincte de la colonisation occidentale. Qu’importe que l’expédition de l’explorateur maritime chinois Zheng He en Afrique fût hautement militarisée et que l’Empire ottoman ait été impliqué lui aussi dans la traite des esclaves africains, ces narratifs sont mis au service d’une compétition pour défendre la «voix de l’Afrique» et sa représentation au niveau multilatéral. Le président turc Recep Tayyip Erdogan n’hésite pas cependant à contester ce rôle à la Chine, pour porter une «troisième voie» valorisant l’entreprise individuelle et le conservatisme, entre le libéralisme progressiste occidental et le modèle chinois du développement contrôlé par l’État, avec une insistance particulière auprès des populations musulmanes et des 26 États africains membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Ce positionnement a notamment permis à la Turquie d’être élue membre non permanent du Conseil de Sécurité en 2008 grâce au vote de 51 États africains, mandat au cours duquel elle dénonça d’ailleurs «un quasi-génocide» mené par la Chine contre les musulmans du Xinjiang.
Plusieurs contrats de BTP remportés au nez des Chinois
Sur le terrain économique, le secteur du BTP constitue le premier champ de rivalité entre les deux puissances émergentes. Le groupe turc Summa a par exemple obtenu et mené à bien de nombreux marchés publics notamment dans le secteur de la construction somptuaire, en réalisant des stades, des hôtels ou des centres commerciaux, au Rwanda, au Sénégal ou en Guinée équatoriale. Ce groupe s’est imposé face à des concurrents chinois pour des projets prestigieux, comme le Parlement de Guinée équatoriale, des centres de convention au Rwanda et des centres commerciaux en Ethiopie. Summa et d’autres grands groupes turcs tels que Albayrak, Limak TAV, ou Yapı Merkezi, obtiennent également des marchés publics assurant à ces entreprises la construction et la gestion d’infrastructures stratégiques, telles que des routes, des chemins de fer, des ports et des aéroports, et en plusieurs occurrences, au détriment d’entreprises d’État chinoises. Le cas le plus médiatisé est l’attribution par l’Ouganda à Yapı Merkezi de la construction du tronçon de chemin de fer Malaba-Kampala, après avoir initialement confié le projet à China Harbour Engineering Company, laquelle n’avait pas honoré son engagement. Entre 2017 et 2021, Yapı Merkezi avait déjà damé le pion aux géants de la construction chinoise CRCC et CCECC en Tanzanie, en remportant successivement les contrats de construction de quatre tronçons de la ligne Dar es-Salaam-Mwanza, après un succès analogue en Ethiopie.
L’opérateur portuaire turc Albayrak, déjà gestionnaire du port de Mogadiscio (Somalie), a étendu ses activités en Afrique de l’Ouest au détriment de China Harbour Engineering, après avoir obtenu en 2018 le contrat pour l’extension du port de Conakry.
Les entreprises turques s’engagent également de plus en plus dans le secteur de l’exploitation des ressources naturelles. Des groupes tels que Lydia Madencilik ou Miller Holding exploitent l’or et le cuivre en RDC, tandis qu’Avesoro, filiale du groupe MAPA, contrôle l’important gisement aurifère de Youga, au Burkina Faso, depuis 2017.
Au Niger, le ministre de l’Énergie turc Alparslan Bayraktar a signé au mois de juillet dernier un accord en vue d’accroître la prospection pétrolière et gazière par des entreprises turques, suivi en octobre d’un autre protocole visant à étendre la « coopération dans le domaine minier à de nouvelles dimensions ». Celui-ci pourrait porter sur l’extraction de l’uranium du pays. Les deux géants chinois de l’énergie CNPC pour le pétrole et CNNC pour l’uranium, qui revendiquent plus de 6 milliards de dollars d’investissements cumulés au Niger, pourraient pâtir de cette concurrence turque.
En ce qui concerne les implantations militaires en Afrique, Ankara est bien partie pour devancer Pékin qui ne possède qu’une base navale sur le continent, à Djibouti. Outre sa base militaire installée en 2017 à Mogadiscio, la Turquie a conclu récemment des accords avec la Somalie autorisant la marine turque à déployer des navires de guerre dans les eaux territoriales somaliennes. Le Soudan lui a également concédé pour 99 ans l’île Suakin en mer Rouge pour qu’elle y installe une base militaire.
Globalement, la Turquie dispose d’un atout singulier dans son offensive multidimensionnelle en Afrique, en l’occurrence sa capacité à jouer sur la fibre de la fraternité musulmane, qui semble encore trouver un large écho sur le continent.