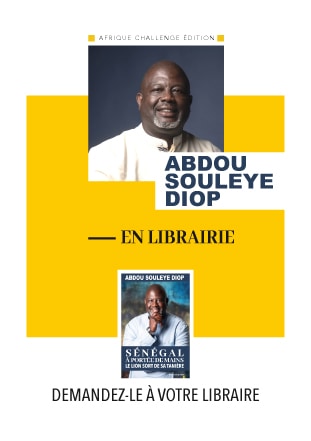«Le leadership est une pratique continue et non un statut».
Vous êtes séduit par l’entrepreneuriat depuis l’âge de 17 ans. Votre participation au YALI 2014 fut une belle consécration de votre engagement. Qu’est-ce qui explique cette fibre entrepreneuriale?
Le programme YALI a été pour moi une expérience extraordinaire qui a renforcé mes capacités à plusieurs niveaux. Ma rencontre avec Barack Obama a été la cerise sur le gâteau. En vérité, je ne suis même pas sûr d’être particulièrement séduit par l’entrepreneuriat en tant que tel ; c’est plutôt l’action contre le statuquo qui m’attire, et celle-ci est souvent appliquée sous une forme entrepreneuriale, mais pas toujours.
Comme toutes les personnes engagées, j’ai eu un déclic à un moment précis de ma vie. J’avais 17 ans et j’effectuais un stage sous la supervision d’une réalisatrice qui faisait un reportage sur la cantatrice Yandé Codou Séne (ndlr, griotte attitrée de l’ex-Président sénégalais Léopold Sedar Senghor). Nous avions traversé plusieurs communes du Sine et du Saloum, dont celle de Diofior. C’était en juillet 2007, juste après l’examen du baccalauréat. J’étais moi-même en 1re à ce moment-là. Par hasard, j’ai assisté à l’annonce des résultats du baccalauréat. Moins de 10% de réussite au premier tour. Ce fut une catastrophe ! Plusieurs sentiments m’ont alors envahi : d’abord le choc, puis la tristesse, l’injustice et l’indignation…
Cette expérience a nourri en moi une volonté de m’engager et de faire quelque chose, aussi petite soit-elle, mais d’agir pour aider ces jeunes en détresse à préparer le Bac. L’année suivante, j’ai créé le programme «Objectif Bac» : une initiative visant à mobiliser de brillants étudiants des universités et écoles du pays afin qu’ils se déplacent bénévolement dans les villes les plus reculées pour offrir leur aide à des milliers de candidats au Bac. Aujourd’hui, ce programme se poursuit et le nombre de bénévoles et bénéficiaires ne cesse de croître.
Le leadership et la transformation sont des notions qui vous tiennent à cœur. Que recouvrent ces deux concepts, selon vous?
Le concept de leadership est à la fois essentiel et dangereux à mon avis. Essentiel dans le sens où il est à la base de toutes actions et de tous changements. Et nous le savons, le changement est essentiel à l’évolution des sociétés et à celle du monde. Mais, il peut être dangereux dans le sens où il est maintenant utilisé pour tout et n’importe quoi. Par exemple, on fait croire à des jeunes en 1re année d’université qu’ils sont des jeunes leaders alors qu’ils n’ont encore rien fait. Le leadership est, pour moi, un état d’esprit, une pratique continue et non un statut. Il doit être au service d’une vision ou d’une conviction. Il doit permettre aux personnes qui le portent de réaliser cette vision en mettant à profit l’ensemble de leurs habilités et atouts afin de transformer, de faire progresser. Et comme le dit l’adage, «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». Une phrase qui, tous les jours, prend pour moi un peu plus de sens.
Après plusieurs expériences, vous avez lancé en 2015 l’initiative «Social Change Factory». Quelles sont les raisons qui ont motivé sa création et quels sont vos futurs défis?
J’ai initié «Social Change Factory» d’abord parce que j’étais convaincu que je ne devais plus porter d’initiative à titre personnel, et que le fait de m’associer à d’autres personnes partageant la même vision du changement social ne pourrait que renforcer l’impact des actions que nous allions mettre en œuvre ensemble. En deux ans, nous avons lancé plusieurs programmes à orientation citoyenne et entrepreneuriale, destinés aux jeunes du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et de Guinée. Un de ces programmes est le concours télévisé «Voix des jeunes».
Nos initiatives et nos approches parfois anticonformistes ont su séduire quelques partenaires stratégiques et, surtout, ont permis d’avoir un impact sur des centaines de jeunes. Nous intervenons parallèlement sur quatre thématiques que nous considérons comme essentielles à l’autonomisation et à la responsabilisation des jeunes : l’Éducation, les Médias, la Citoyenneté et la Justice. Des thèmes qui sont abordés de façon engageante avec une orientation systématique vers les solutions.
Justement, l’émission «Voix des jeunes», lancée en avril 2015, constitue l’un de vos projets phares. Concrètement, en quoi consiste-t-elle?
«Voix des jeunes» est un programme télévisé qui met de l’avant et en œuvre des centaines de solutions efficaces ayant réussi à résoudre des problèmes socio-économiques dans diverses communautés du continent et du monde. Entre formations, recherches, immersions, services communautaires et voyages, les participants au programme en ressortent transformés et boostés pour mieux s’engager au sein de leurs communautés.
Outre le Sénégal, vous avez intégré cette année la Côte d’Ivoire et la Guinée. Cette année, la finale s’est déroulée au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan. Qu’est-ce qui explique cet élargissement à d’autres publics?
En effet, dès la création même de ce programme nous visions l’Afrique. Le Sénégal n’était que le point départ. Nous avons pris le risque de dupliquer le concept dans deux autres pays après seulement une édition et ça a marché. Nous avons ainsi voulu ponctuer cette deuxième saison par un évènement de taille au sein d’une grande institution africaine et nous avons choisi la BAD (Banque africaine de développement, ndlr). La finale régionale opposant les équipes gagnantes de chaque pays s’est déroulée le 3 février dernier au siège de la BAD, à Abidjan. Un évènement historique, selon des administrateurs de la banque. Un évènement qui a même su rapprocher celle-ci de la jeunesse du continent. En 2017, nous planifions de lancer le concept au Tchad, au Burkina Faso et en Gambie. D’ici 2020, nous souhaitons porter le concept «Voix des jeunes» dans 16 pays du continent.
Développer un tel projet n’est pas chose aisée. Qu’en est-il du financement?
Absolument ! Ce n’est pas chose aisée, d’autant plus qu’un programme comme celui-ci coûte très cher vu la pluralité de ses activités, notamment la production audiovisuelle. Le coût du projet par pays tourne autour de 150.000 dollars. Pour une association qui a moins de deux ans, cela n’a pas toujours été simple, mais nous y sommes arrivés. Cela dit, rien de tout ça n’aurait été possible sans ces partenaires qui nous font confiance. Et je les remercie, non seulement pour leur soutien financier et logistique, mais pour leur confiance et pour leur engagement réel à nos côtés. Il n’est pas facile d’accepter de soutenir des programmes dont les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Mais ici, il ne s’agissait ni de chiffres, ni de montants, mais bien de présent et d’avenir. Car refuser d’investir dans le présent, c’est hypothéquer dangereusement l’avenir.
Vous dites souvent que «le défi du 21e siècle est un défi d’humanité, pas de compétences». Autrement dit?
À mon avis, le grand défi de ce siècle n’est, en effet, pas une question de compétence ni de performance, mais plutôt d’humanité. Il est nécessaire que nous arrivions à ramener l’humain au cœur de nos actions, de nos systèmes et de nos politiques. Et c’est pour cette raison que nous devons amener ces jeunes étudiants, qui constituent les élites émergentes de notre continent, à comprendre que penser et œuvrer davantage pour le bien-être de l’Homme rendra le monde meilleur et plus juste. Les travers de notre époque, les grandes inégalités économiques et sociales, les crises politiques, le chômage et la radicalisation sont principalement dus à la désacralisation de l’être humain, de son bien-être au profit d’autres intérêts.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs du continent?
Je leur dirais tout simplement de toujours se rappeler la raison qui les motive à entreprendre dans un sens ou dans un autre. C’est cette raison qui leur permettra de se relever après une chute. Et le plus grand défi de l’entrepreneur n’est pas la chute en elle-même, mais la capacité de se relever. Nelson Mandela disait : «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends». Et en tant qu’entrepreneurs, il est bon pour nous d’apprendre ; cela ne peut que nous permettre de faire encore mieux.
Propos recueillis par Elimane Sembène