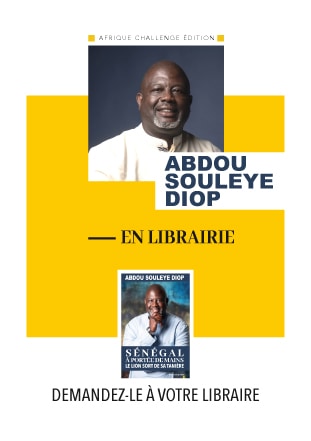Le Covid-19 met à rude épreuve les systèmes de santé du monde. L’Afrique, contrairement aux autres continents, est relativement épargnée. Une résilience sanitaire qui devrait contraster avec l’insécurité alimentaire qui menace plusieurs millions d’Africains, autre dégât collatéral de ce fameux virus. La pénurie alimentaire sur le marché mondial prévue par l’OMC, avec son corollaire de répercussions négatives sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, pourrait engendrer de lourdes conséquences sur les habitudes de consommation. La forte dépendance du continent aux importations la place dans une position précaire, surtout avec l’éventuelle flambée des prix.
Le coût des importations alimentaires en Afrique subsaharienne est estimé à 48,7 milliards de dollars en 2019, soit 3,8% de plus par rapport à 2018, d’après le rapport « Perspectives de l’alimentation » de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les céréales et les poissons sont les produits les plus importés avec respectivement 17,5 milliards de dollars (soit 36% des dépenses) et 4,8 milliards de dollars. S’en suivent la viande, le lait, le sucre, les légumes, les oléagineux, etc. Concrètement, l’Afrique est le premier importateur de riz au monde avec environ 30% des importations mondiales. Pas moins de 24 millions de tonnes (dont 5,2 millions de tonnes en Afrique de l’Ouest) de cette denrée traversent chaque année plusieurs ports avant de se retrouver sur nos assiettes, soit 7 milliards de dollars de dépenses. L’Afrique subsaharienne est le troisième importateur régional de blé derrière l’Asie du Sud-Est et l’Afrique du Nord.
Cette situation constitue une piqûre de rappel pour l’Afrique quant à l’impérieuse nécessité de repenser nos modes de production pour relever le défi de la sécurité alimentaire. Pour ce faire, il urge d’activer trois principaux leviers. D’abord, la production à grande échelle. Et ce n’est pas les hectares qui manquent. 65% des terres agricoles du continent sont inexploitées, une immense jachère qui mérite d’être exploitée et valorisée. Faudrait-il encore déployer des financements nécessaires pour permettre aux agriculteurs d’accroître leurs rendements et d’investir dans ces terres. L’implication des États et du secteur privé sera primordiale pour résorber le déficit de financement de l’agriculture estimé entre 21 et 30 milliards de dollars.
Produire en masse c’est bien, transformer c’est encore mieux. Et c’est là que le bât blesse. Prenons juste l’exemple du cacao. L’Afrique qui assure 71% de la production mondiale n’en transforme que 4%. Le paradoxe est saisissant en Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de l’or brun (environ 40% de la production), où la majeure partie de ces fèves est exportée, sans valeur ajoutée. Des multinationales les transforment et revendent leurs produits sur le marché africain, souvent à prix d’or. L’« université du cacao et du chocolat » annoncée depuis 2015 par le gouvernement ivoirien n’est pas encore sortie de terre. Que dire du coton africain dont plus de 90% de la production est exportée sans plus-value. Miser sur l’agro-industrie stimulera la consommation locale et permettra aux exploitants agricoles de diversifier leur production, de séduire une classe moyenne passionnée de produits transformés et d’exporter leurs marchandises.
Enfin, l’intégration des technologies dans la chaîne de valeur agricole, en collaboration avec les startups technologiques, permettra aux acteurs d’améliorer leurs systèmes de cultures et favorisera leur inclusion financière.
Par Élimane sembène